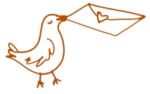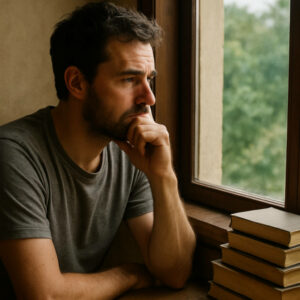Rodéos urbains : un phénomène en hausse ?
La violence de l’accident d’Évian-les-Bains, survenu ce samedi 10 mai, a marqué un tournant. Un sapeur-pompier volontaire de 38 ans, père d’un jeune enfant, lutte aujourd’hui entre la vie et la mort après avoir été délibérément percuté par un automobiliste de 19 ans lors d’un rodéo urbain. Ce drame, loin d’être un cas isolé, soulève une vague d’indignation à travers le pays et relance avec force le débat sur un phénomène en pleine recrudescence.
Une pratique illégale devenue quotidienne
Les rodéos urbains, ces démonstrations de puissance motorisée à moto, en scooter ou en voiture, se sont banalisés dans les quartiers urbains et périurbains. Manœuvres dangereuses, conduites acrobatiques, excès de vitesse : ces comportements, souvent diffusés sur les réseaux sociaux, exposent les participants et les riverains à des risques mortels.
La loi de 2018 a bien reconnu ces pratiques comme un délit, passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende — jusqu’à cinq ans en cas de circonstances aggravantes — mais les sanctions restent, selon de nombreux élus locaux, trop peu appliquées. Le bilan est lourd : en 2023, près de 3 000 engins ont été saisis, et plus de 86 000 opérations policières ont été menées. Pourtant, les drames continuent.

Une victime de plus, un seuil franchi
Le cas d’Évian est particulièrement choquant. Alertés par le vacarme d’un rodéo matinal sur un parking en face de leur caserne, des pompiers sont sortis pour tenter de faire cesser l’agitation. L’un d’eux, en photographiant un véhicule, a été violemment percuté dans le dos. Le conducteur, connu des services de police pour usage et trafic de stupéfiants, a été interpellé peu après. Son véhicule contenait des bonbonnes de protoxyde d’azote et de l’alcool, et son permis était suspendu.
« C’est un acte abject, une tentative d’homicide gratuite contre un homme venu protéger », a déclaré le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, en déplacement à Évian.
La réaction politique : généraliser les courses-poursuites
Face à l’émotion nationale, Bruno Retailleau a annoncé une nouvelle doctrine de fermeté : la généralisation des prises en chasse des véhicules en infraction. Jusqu’à présent, seules certaines zones comme Paris engageaient ce type de poursuites, par crainte de risques collatéraux.
« Partout où ces délinquants motorisés sèment la terreur, les forces de l’ordre auront désormais pour consigne de les poursuivre physiquement », a affirmé le ministre lors de l’émission Le Grand Jury.
Une déclaration saluée par certains élus, mais qui soulève aussi des inquiétudes : faut-il prendre le risque d’accidents supplémentaires pour mettre fin à ceux provoqués par les rodéos ? La question divise les syndicats de police et les associations de victimes.
La réponse judiciaire et locale : vidéosurveillance, saisies, prévention
Sur le terrain, la police affirme renforcer sa stratégie : quadrillage des zones sensibles, opérations ciblées, enquêtes avec appui de la vidéosurveillance. Le recours à des drones est étudié, et les bailleurs sociaux sont associés à la prévention.
La porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil, insiste : « Nous ne poursuivons pas systématiquement, mais nous agissons de manière proportionnée et encadrée juridiquement. »
Une fracture sociale révélée
Le profil des auteurs — souvent jeunes, non casqués, issus de quartiers populaires — alimente un débat plus large sur l’exclusion sociale et le rapport à l’autorité. Certains élus pointent un échec global : échec de l’éducation civique, désengagement parental, absence de perspectives.
« On fabrique des barbares quand on oublie d’enseigner les limites », a lancé Retailleau.
Une tragédie de plus, et combien d’autres ?
Avant Évian, il y avait eu Vallauris : Kamilya, 7 ans, percutée par un motard en pleine acrobatie sur un passage piéton. Avant elle, des dizaines d’autres blessés ou tués. Combien faudra-t-il encore d’accidents, de vies brisées, pour que le phénomène recule ?
Inscription
Vous souhaitez recevoir le Courrier de nos terroirs par email ?
Inscrivez-vous, c’est gratuit !